J’ai failli mourir au Congo
Malgré toutes les prévisions que les voyageurs peuvent faire, en dépit de toutes leurs projections, un voyage est toujours soumis à l’aléatoire. C’est ce même aléatoire qui a failli m’être fatal en République démocratique du Congo, un pays que j’ai découvert au travers de ses gorilles du parc Virunga, de sa population locale et de son volcan Nyiragongo. Et c’est lors de la visite de ce fantastique pays que pour la première fois de mon existence, j’ai failli mourir en voyage, en y faisant une mauvaise rencontre, mais en vivant un accident dont les conséquences sur ma santé furent physiquement préjudiciables. C’est de cet accident dont je vais vous parler, ainsi que de sa gestion et de mon rapatriement en urgence en France au travers de ce récit.

La République démocratique du Congo est le plus grand pays d’Afrique ; il a pour capitale Kinshasa et ne doit pas être confondu avec le Congo voisin qui a pour capitale Brazzaville.
La République démocratique du Congo est un pays splendide. Pourtant et malgré ses trésors touristiques, le pays est peu visité par les étrangers du fait d’une procédure d’obtention de visa compliquée. Cependant, dans l’Est du pays, l’état a mis en place une procédure de visa facilitée pour tous les étrangers qui souhaitent en visiter les parcs nationaux ou le volcan Nyiragongo.
Etant donné que j’effectuais un voyage en Ouganda et au Rwanda, il était pour moi impossible de ne pas visiter le Congo et découvrir les trésors qu’il propose.
Pour obtenir ce visa facilité, j’ai ainsi contacté une agence locale : Go Congo qui m’a réservé une visite du volcan Nyiragongo et des gorilles du parc Virunga sur le site officiel : https://visitvirunga.org ; l’accord d’obtention du visa fut confirmé par mail par l’agence et je pus le récupérer au poste frontière terrestre de la ville de Goma lors de mon entrée dans le pays.
Le prix de l’entrée du parc Nyiragongo est de 250 dollars US ; le permis visite des gorilles se paye en ce qui le concerne 400 dollars US, mais une promotion spéciale me permis d’obtenir une réduction de 50 % (au Rwanda, le permis gorille se négocie aux alentours de 800 à 1000 dollars).

Après avoir découvert les gorilles du parc Virunga lors de ma deuxième journée dans le pays, je retourne à mon hôtel et je retrouve Michel, un belge de près de 60 ans qui gère l’agence Go Congo. Entre les coupures de courant fréquentes dans la région, nous prévoyons l’ascension du volcan le lendemain.
- Il faudrait que tu prévoies l’achat de nourriture avant de commencer ton trek.
- Mais, tu ne viens pas avec moi, Michel ?
- Impossible à mon âge. L’ascension dure près de 8 heures et même les plus entraînés ont des difficultés à la faire d’un trait. C’est pour cette raison que je t’ai réservé un porteur. Il portera ta nourriture ; tu sais, les porteurs sont comme les sherpas du Népal ; sans eux, beaucoup de touristes ne parviendraient pas jusqu’au sommet.
- Et que vais-je trouver au sommet ?
- Depuis quelques années, le parc Nyiragongo a construit des cabanes dans lesquelles tu pourras poser ton sac de couchage. Et c’est dans ces cabanes que tu pourras te faire à manger.
- Mais, le parc propose un forfait repas à 50 dollars. Qu’est-ce que ça vaut ?
- Si tu aimes les salades, c’est bon, mais comme tu m’as dit que tu voudrais te faire un barbecue au sommet, c’est mieux de garder cette somme pour t’acheter de la nourriture.
Un barbecue au sommet du volcan, j’avoue que l’idée me trottait dans la tête depuis un bon bout de temps, essentiellement depuis que j’avais découvert dans des manuels de voyage, les photographies de ce monstre séculaire en perpétuelle agitation.
- D’accord, alors que dois-je acheter ?
- Alors, il te faudra de la viande, des épices, des pommes de terre, de l’huile et du charbon de bois. C’est avec la viande ce qui coûtera le plus cher.
- Cher, le charbon de bois ?
Michel m’expliqua alors que le manque d’électricité avait porté le charbon de bois au sommet des biens indispensables que les habitants achetaient ; fabriqué illégalement, il faisait depuis quelques temps l’objet d’un trafic lucratif des braconniers et son commerce illégal était sévèrement réprimé par les autorités. Lorsque je questionnai Michel sur la présence des braconniers dans ce trafic, Michel m’exposa les origines fallacieuses de ce charbon de bois, dont je ne soupçonnai aucunement l’existence. En effet, les braconniers avaient depuis longtemps, abandonné la chasse aux gorilles et aux animaux sauvages, du moins pour un grand nombre d’entre eux et qu’ils s’étaient rabattus sur le charbon de bois, trafic lucratif et bien moins risqué que l’abattage d’animaux surprotégés. Le charbon de bois comme son nom l’indique a pour matière première le bois des forêts dans lesquels vivent les gorilles et les animaux sauvages. En coupant les arbres de ces parcs régionaux, les forêts disparaissent progressivement, ce qui réduit l’habitat de vie des animaux. Le gouvernement a donc décidé de frapper fort sur les trafiquants de bois et les petites mains qui le transforment en contrôlant la flambée des arbres. Seul le charbon de bois importé des autres régions du pays est autorisé à la vente, ce qui amène son prix à 5 dollars US le sachet dont la taille suffit à peine à cuir un repas, une impossibilité pour une grande majorité de la population.
Michel me précise tout de même : le forfait repas inclus également les encas qui seront distribués durant le trajet, mais étant donné que le parc ne note pas le nom de ceux qui ont payé le forfait, des boissons et des friandises sont distribués à tous les grimpeurs, sans distinction. Donc, tu profiteras d’un bon repas le soir avec Paulin, mon assistant qui t’accompagnera durant le trek et tu recevras comme les autres une petite barre de chocolat.
Il rit et rajoute : « une barre de chocolat, je doute que cela soit suffisant pour te redonner l’énergie que tu vas dépenser lors de la montée ». Son petit rictus ne me disait rien que vaille, mais néanmoins, je ne pouvais plus faire marche arrière, même si la projection d’une montée de près de 4000 mètres de lourdes pentes m’épuisait. Après une énième coupure de courant, je saluai Michel, Paulin qui nous avait rejoint et je me plongeai dans mon lit en sachant que la journée du lendemain allait m’obliger après plus d’un mois de voyage dans l’Est de l’Afrique, à puiser dans mes réserves.
Aux aurores, je me lève, l’esprit encore embué. Je rejoins Michel petit-déjeunant. Il me salut, toujours enjoué et continue de boire son lait. Je bois un café rapidement et Paulin nous rejoint accompagné de notre chauffeur avec lequel nous allons effectuer les deux heures de route qui nous sépare du parc du volcan Nyiragongo.
Mais avant de nous lancer sur la route, nous devons acheter le matériel de base qui nous servira durant les deux jours que dure le trek : une journée pour monter au sommet du volcan et l’autre jour pour en redescendre.
Nous saluons Michel qui nous a organisé pour le lendemain après-midi la visite d’un village de pygmées, que nous aurons le temps de découvrir avant mon départ pour le Burundi voisin.

Nous faisons une première halte dans le centre-ville de Goma afin d’acheter de la viande, un bon kilo de bœuf ; néanmoins, la viande étant précieuse dans ce secteur de l’Afrique, nous devons tenter trois fois notre chance pour trouver un boucher qui en détient. Nous avons en outre de la chance puisqu’elle est fraîche, l’animal venant d’être abattu dans la nuit. Le kilo nous revient à une dizaine d’euros. Nous continuons chez un vendeur itinérant chez lequel nous achetons quelques fruits et quelques légumes ; dans une épicerie, nous trouvons de l’huile et des épices ; il ne nous manque plus que le charbon de bois, mais nos tentatives différentes pour en trouver sont vaines ; Paulin décide alors d’en acheter sur le bord de la route.
Nous quittons la ville de Goma. Nous faisons un arrêt dans un petit village et parvenons à acheter du charbon de bois ; le vendeur nous certifie qu’il ne provient pas de bois braconné ; néanmoins, aucune preuve ne nous est apportée ; nous n’en demanderons même pas, la provenance du charbon de bois étant impossible à tracer.
Après une route sinueuse et difficile, nous entrons dans le parc du volcan Nyiragongo. Nous nous rendons dans une petite guérite où un garde vérifie mon identité. Une fois que mon identité a été validée au travers d’une étude furtive de mon passeport, le garde nous valide l’entrée ; nous rejoignons une vingtaine de touristes du monde entier qui patiente depuis près d’une heure ; il faut dire qu’ils sont venus uniquement pour effectuer ce trek. Lorsque je les questionne sur les autres activités qu’ils vont effectuer dans le secteur, ils me répondent qu’après le trek, ils retourneront au Rwanda voisin, un pays selon eux beaucoup plus sûr et que la mauvaise réputation de la région de Goma ne leur donne pas envie de la découvrir.
Il faut dire que partout dans le monde, la région est présentée comme dangereuse et non sécuritaire ; cette insécurité due aux poches de factions rebelles émanant de l’ancienne guerre rwandaise entraîne la région dans une sorte de fantasmes. Il est sûr que l’endroit peut présenter des risques pour un voyageur qui s’y aventurerait seul et se rendrait dans des localisations problématiques, mais en compagnie d’un habitant local, il y a peu de chances que des problèmes surviennent, la population locale étant attachante et bienveillante envers les étrangers.

Après une petite réunion en contrebas du volcan, aux abords de l’entrée du parc, le ranger nous présente les militaires qui vont nous accompagner durant la montée, non pas que l’endroit soit dangereux, mais le parc préfère ne pas prendre de risque. Le ranger, en Français nous énumère les règles de sécurité que nous devrons respecter : rester ensemble, ne pas se dépêcher, beaucoup boire et il nous propose des bâtons de marche coûtant la modique somme de 5 dollars US.
Les américains représentant la bonne moitié du groupe s’arrachent les bâtons de marche et une fois les emplettes terminées, nous pouvons entreprendre cette montée, une boule au ventre. Non pas à cause d’une hypothétique peur, mais en regardant la hauteur de ce volcan qui nous fait face comme s’il semblait nous prévenir : « ne tentez pas, vous n’y arriverez jamais ! » Et c’est vrai qu’il est majestueux semble impossible à atteindre ! La montée va être longue et éreintante.

Cette difficulté se précise dès les premiers mètres. Le groupe n’a plus l’entrain du départ qui a eu lieu il y a quelques minutes à peine ; le terrain est glissant et les pierres présentes sur le site ne facilitent pas l’épreuve. Après une heure de marche, une dizaine de grimpeurs est à la traîne. Fort heureusement, le premier stop est salvateur ; des barres vitaminées sont distribuées et nous pouvons en profiter pour souffler. Nous regardons nos porteurs, qui pour 25 dollars par jour subissent cette épreuve près de trois fois par semaine, sans se plaindre avec une étonnante facilité. Les quatre militaires qui nous accompagnent, leur arme en bandoulière semblent aussi épuisés que nous ; pourtant le trek n’est pas terminé, loin de là ; il ne fait que commencer.
Les deux heures de montée qui suivent sont éprouvantes ; les muscles sont tiraillés et le mental perd de sa superbe en regardant la distance importante qu’il reste à parcourir ; grimper une montagne est analogue à escalader un mur : ne jamais regarder ce qui se passe autour de soi.
Le deuxième stop diffère du premier dans le sens où même les plus téméraires sont allongés comme des loques sur le sol ; les filles ne font plus attention à leur posture : maquillées, démaquillées, propres ou sales, qu’importe ; les garçons semblent avoir oublié leur assurance. Plusieurs se plaignent de douleurs dans les cuisses. Ah, il est loin le temps du matin où les américains chantaient leur hymne national en conquérant. En cet instant, ils ressemblent plus à des marins esseulés sur un radeau à la dérive.
Le troisième arrêt signe le déjeuner avec une heure de retard sur l’heure normale, avec une pression supplémentaire ; la moitié du chemin vient d’être parcourue, ce qui signifie qu’il nous reste au bas mot près de 4 heures de montée, en sachant que la partie de l’ascension restante est la plus ardue et que le soleil se couchant à 18 h 00, nous devons être arrivés vers 17 h 00 pour en profiter, soit quatre heures pour parcourir près de 2000 mètres présentant un dénivelé important.
La reprise s’avère difficile ; à présent, l’intégralité du groupe est à la traîne. Les américains ne ressemblent plus à rien. Moi non plus par ailleurs ; mes jambes ont des difficultés à avancer et seul le bâton de marche gentiment prêté par mon porteur me permet de me maintenir pour obtenir une poussée suffisante et mettre un pied devant l’autre.
Vers 16 h 00, alors que nous arrivons au dernier arrêt avant la montée finale sur une sorte de pyramide avec une pente aussi aigue que celle des pyramides d’Egypte, une averse s’abat subitement sur nous ; nous avons alors la chance de nous trouver aux abords d’une cabane en bois qui servait d’abri aux militaires lorsque les cabanons du sommet n’existaient pas encore.
Alors que les porteurs récupèrent l’eau de pluie qui tombe, nous admirons au travers d’une fenêtre sans vitre ce géant majestueux que nous sommes en train d’affronter depuis plus de sept heures déjà. Mais la bataille ne sera pas sans victime ; un Indien s’effondre devant nous ; il faudra toute la persuasion d’un des militaires qui parle Anglais pour lui donner le courage de repartir.
Les derniers mètres sont les plus épuisants ; mais galvanisés par le sommet qui se rapproche, nous avançons plus rapidement. Et après avoir dépassé les cabanons en bois que nous avons rejoint, nous n’avons qu’à pencher notre tête pour découvrir le cratère de ce géant que nous avons vaincu. Un grondement et une expulsion de lave nous montre son mécontentement ; les américains reprennent leur chant comme si de rien n’était. « God save America ! »

Durant près de deux heures, je suis comme hypnotisé par ce spectacle d’une nature violente qui semble se tempérer ; le lac aux mille couleurs de rouge se dévoile face à nous mais se met à nu lorsque la nuit tombe ; un œil envoutant tournoie dans une symphonie où les percussions sont à l’honneur.

Venant m’extirper de mon hypnose, Paulin m’invite à rejoindre le cabanon dans lequel il prépare un repas à l’Africaine : une belle pièce de bœuf que nous partagerons avec deux porteurs et un militaire, ainsi que des pommes de terre cuites à l’huile sur un feu de charbon de bois.

Une fois repus, nous allons nous coucher. J’en profite pour me lever la nuit afin d’admirer encore et encore ce monstre qui tel un cyclope ne me lâche pas du regard.
Le lendemain matin, je suis frigorifié ; je ne pensais pas qu’il pouvait faire si froid au sommet d’un volcan et les cabanons ayant été construits avec les moyens du bord, la conservation de la chaleur ne devait pas faire partie du cahier des charges de l’architecte qui les a conçus.
Le groupe d’Américains, les yeux encore fermés de la courte nuit qu’ils viennent de vivre m’invitent à prendre le petit-déjeuner avec eux. Nous sympathisons mais en cette heure matinale, je n’ai pas la chance de les entendre chanter. Certains se demandent ce qu’ils font là : courbaturés, épuisés, je sais qu’ils savent que je sais qu’à ce moment précis, le désert de l’Arizona leur manque énormément. Après, il convient de relativiser, cette ascension quand bien même difficile, n’est pas une épreuve de survie. Juste une découverte qui nécessite une dépense énergétique un peu plus importante que la visite d’un musée. Du moins, c’est ce que je me disais encore à ce moment précis, l’air satisfait de me trouver là où je me trouve.
Après une heure de répit, il est temps de redescendre vers la civilisation ; Paulin me propose son aide pour le retour en me soulageant de mon sac à dos ; je l’en remercie et commence prudemment à redescendre en faisant bien attention de ne pas tomber, les pierres ayant été rendues glissantes à cause de la rosée du matin qui ne s’est pas encore totalement évaporée.
Les américains se trouvent en tête ; chacun utilise son bâton de marche pour prendre appui sur le sol.
Je me trouve dans le groupe qui termine le peloton. Juste avant les porteurs qui nous suivent en souriant, soulagés que leurs sacs lourds qui contenaient la nourriture ont été vidés.
Soudainement, alors que je m’apprête à poser mon pied pour me réceptionner lors de mon avancée, un éboulement de terrain fait glisser des pierres sur mon point d’appui, ce qui m’empêche de me stabiliser. Je me vois obligé d’éviter ces pierres sous peine de glisser et de me réceptionner un peu plus bas ; néanmoins, la gravité entraîne tout corps vers le sol ; alors que je m’apprête à poser mon pied, un autre apprentissage mécanique va m’entraîner dans un chaos incontrôlable : l’Energie cinétique.
Chaque pas que je fais augmente ma vitesse de manière exponentielle ; étant donné la pente, même sans effort, je suis entraîné dans une fuite en avant que je ne parviens à stopper ni à ralentir ; je suis entraîné dans une spirale infernale qui amène à moi le décor à grande vitesse un peu comme si je me trouvais dans un train. J’ai l’impression que le sommet s’éloigne au fur et à mesure que je dépasse les membres du groupe qui descendent précautionneusement et dont j’aperçois le regard, mi terrifié, mi circonspect, se demandant si je joue à descendre rapidement ou si je me trouve dans une situation inextricable.
Je ne possède pas mon sac, confié un peu avant ma descente infernale à Paulin qui se trouve déjà loin de moi. Je parviens malgré la vitesse à réfléchir et à analyser la situation sans paniquer ; je sais que si je tombe, je meurs, les cailloux acérés omniprésents ne me laisseraient que peu de répit ; je sais également que si je ne parviens pas à contrôler ma chute, je me retrouverai dans une situation où la vitesse m’entraînerait dans un roulé boulé qui ne me laisserait que peu de chance de survie.
Alors que je descends, une course effrénée pour ma survie se joue ; une course dans ce moment, quelle ironie ! Je ne sais si l’adrénaline fabriqué par mon corps dans ce moment d’excitation intense me permet de maîtriser la situation mais quoi qu’il en soit, j’ai l’impression alors que ma vitesse augmente, de regarder le décor autour de moi qui défile au ralenti. Je parviens même tel un super héros qui découvre ses pouvoirs à entendre le battement des ailes d’une mouche qui se trouve à quelques mètres de moi. Non, je déconne ! Je suis en train de dévaler la pente d’un volcan comme une merde et je me sens comme cette mouche avant qu’elle se fasse aplatir par une main dérangée de sa présence.
Mais, il est vrai que je suis capable d’analyser la situation sans avoir peur ; je sais qu’une panique causerait irrémédiablement ma fin. Je parviens même à doubler les Américains pourtant loin devant.
C’est alors que j’aperçois Hugues, un anglais avec qui j’avais discuté la veille. L’homme assez robuste se tient à une espèce de roche ; il est le dernier membre du groupe en tête de file ou du moins, le premier, tout dépend son point de vue. A ce moment, comme par instinct, je me jette en arrière en essayant de freiner ma descente avec mes fesses ; les roches acérées me découpent le pantalon, mais je dois continuer de glisser en essayant tant bien que mal de ne pas trop exposer mon dos et surtout pas ma tête. Entendant ma venue, Hugues se retourne ; en l’espace d’un instant, le choc est terrible ; je fais tout mon possible pour ne pas trop l’atteindre et lui attraper les genoux en place et lieux du torse, même si ce risque pour moi de subir la chute de son corps me blesserait davantage. Je n’ai pas le droit néanmoins de le blesser ; il doit simplement me servir de pilier d’arrêt.
Peu avant le choc, son regard en dit long sur sa crainte : il sait et je sais ce qu’il va advenir : une collision d’une rare violence. Hugues tombe sur le sol ; je suis projeté dans les airs et retombe quelques mètres plus loin en roulant boulant mais finalement, je parviens à m’arrêter. Je reprends mes esprits en entendant hurler les militaires que j’aperçois venir vers moi en compagnie de Paulin ; je ne sais plus combien de temps s’est écoulé entre le choc et leur venue, mais je parviens tout de même à analyser les dégâts. J’ai mal aux jambes, j’ai du sang sur le visage ; mon nez et ma touche me font mal. J’ai une forte douleur dans les côtes. Je regarde Hugues qui se tient la jambe droite. Mais, il a l’air de ne pas avoir subi trop de contusions.
Paulin arrive vers moi en premier. Il est blanc, ressemblant à un Norvégien allergique au soleil alors que la veille, dans une discussion il m’avait fait part de sa fierté de ne jamais rougir : « plus facile avec les filles » me disait-il. Il me questionne sur mon état et m’aide à me relever ; les militaires me donnent les premiers soins et m’annoncent la nouvelle : aucun hélicoptère n’est disponible dans la région ; je vais devoir descendre à pied. Paulin et les militaires veulent m’épauler, mais descendre en leur compagnie est pour moi beaucoup plus dangereux car plus instable.

Le reste du groupe arrive jusqu’à moi, mais je ne pense qu’à m’excuser à Hugues qui boîte. Je l’ai abîmé le pauvre, mais gentil comme il est, il me répond que tout va bien, qu’il doit s’agir simplement du choc ; le médecin qui l’examinera au poste des rangers suspectera une entorse ; quelques jours de repos et il n’en paraîtra plus.
En attendant de rejoindre le poste frontière, synonyme de retour à la civilisation, je dois parcourir plusieurs kilomètres dans mon état. Si lors de la montée, chaque pas était difficile, lors de cette descente, alors que je suis aidé de deux bâtons de marche, chaque pas est un calvaire.
Un problème n’arrivant jamais seul, une averse nous tombe dessus juste avant de traverser une forêt où le taux d’humidité est important, ce qui n’arrange pas mes plaies ouvertes, qui s’infectent les unes après les autres comme des éléments en chaîne. Et ce n’est pas le désinfectant posé sur mes crevasses qui pourrait changer la donne ; malgré la bonne volonté des rangers, ce désinfectant n’en a depuis plus longtemps que le nom.
Après plusieurs heures d’efforts intenses, je parviens à regagner bon dernier la guérite des rangers où les premiers soins me sont donnés. Notre chauffeur arrive rapidement.

Avant de monter dans la voiture, je salue mon sauveur involontaire qui entre dans une voiture en boitant. Dans la voiture, Paulin qui a depuis retrouvé ses esprits et sa couleur d’origine appelle Michel, qui organise une prise en charge à l’hôpital de Goma.
Nous récupérons Michel, horrifié et peiné par mon état et rejoignons un hôpital dont la construction a été assuré par l’Union européenne. Néanmoins, alors que cette construction était censée apporter de l’aide aux habitants de la ville, les notables qui se le sont accaparé en font payer les soins au prix fort.
Nous entrons dans une salle d’attente bondée et rencontrons un infirmier qui m’ausculte rapidement avant de me faire passer chez un médecin qui suspecte deux entorses : chevilles gauches et chevilles droites, ainsi que des côtes cassées.
Alors que le médecin s’éloigne pour parler avec sa direction, l’infirmier de garde me nettoie les plaies et manquant de sparadraps, en récupère un sur le pied d’un malade alité. Il s’apprête à me le poser sur le crâne ouvert lorsque j’effectue un recul de la tête. Je ne sais pas s’il ne m’avait pas vu le voir procéder de la sorte ou s’il n’a pas fait exprès, mais quoi qu’il en soit, je ne souhaite plus de soin de la part de cet hôpital. Je ne désire pas attraper une maladie disparue depuis des années, tant l’hygiène dans les lieux laisse à désirer.

Je vais patienter dans la salle d’attente de l’extérieur et me saisit de mon téléphone portable pour contacter mon assurance voyage. En effet, possédant un contrat habitation au sein de la société Axa, une garantie incluse dans mon contrat me fournit gracieusement une assurance voyage sans frais supplémentaire ; néanmoins pour être valable, le voyage ne doit pas dépasser les trois mois consécutifs, ce qui est mon cas.
Premier problème, je ne connais pas le numéro de téléphone d’Axa assistance ; je dois téléphoner en France à mes parents pour le leur demander. Je leur explique rapidement la situation et après les hurlements à l’autre bout du fil, je parviens à les rassurer sur mon état, ce qui leur donne la possibilité d’appeler à leur tour mon frère pour effectuer une recherche sur Internet et me donner le numéro tant précieux. Pendant ce temps, Michel appelle ma compagne pour lui relater l’accident et doit faire également face à des hurlements, puis à une anxiété légitime de sa part.
Je contacte avec mon téléphone l’assurance Axa ; un conseiller commence à me poser plusieurs questions ; j’essaye de me dépêcher dans mes réponses, étant donné que la minute d’appel coûte aux alentours des 4 euros et la minute reçue, aux alentours des 3 euros.
Malgré mon impératif financier téléphonique, mon correspondant cherche tous les points litigieux qui pourraient justifier une exclusion de la prise en charge ; néanmoins, il est mal tombé ; j’ai chuté après un accident qui n’est pas de mon fait ; il ne peut m’exclure de la prise en charge ; il décide alors ensuite de me passer le service médical, signe que mon dossier est pris en charge.
Après une dizaine minute d’attente, je parle à un médecin du service à qui je dois expliquer à nouveau toute l’affaire. Le médecin régulateur, beaucoup plus compréhensif que mon précédent interlocuteur demande à parler au médecin de l’hôpital qui lui dévoile mes blessures, en les minimisant afin que je ne sois pas dans l’obligation de rentrer en avion sanitaire que le médecin de l’assureur était prêt à m’octroyer ; le médecin de l’hôpital lui précise ensuite qu’une classe plus spacieuse serait plus agréable pour mon retour, ce qui amène le médecin régulateur à me proposer un retour en Business class.
Le médecin régulateur de l’assurance décide alors de s’adresser à un assisteur présent au Congo, en l’occurrence une assisteuse qui se trouve dans la capitale à Kinshasa, un assisteur étant un partenaire médical local qui s’occupe de gérer les prises en charge des éventuels assurés.
Je patiente, je patiente, je patiente. Après deux heures, je rappelle l’assurance qui me demande de patienter.
Je patiente à nouveau au milieu des autres malades, dehors alors qu’une averse tombe, alors que je vois les allers et retours des blessés qui sont portés à même les bras et sont déposés devant la porte de l’hôpital lorsqu’ils ne peuvent pas payer les soins. La situation me choque, l’Union Européenne a financé la construction de cet hôpital pour garantir un accès égalitaire aux soins des habitants, ce qui n’est aucunement le cas. La devise familièrement parlant de l’hôpital serait plutôt : « Paye ou meurs ! »

Alors que le soleil commence à faiblir, je reçois un appel de mon assisteuse basée à Kinshasa, qui m’annonce qu’elle ne pourra pas m’aider, étant donné qu’elle ne connaît pas le secteur et qu’elle n’est en relation avec personne sur place.
Je rappelle grâce au téléphone de Michel, l’assurance Axa, qui m’explique qu’au Congo, je dois me débrouiller seul, mais que si je parviens à sortir du pays, au Rwanda voisin, une autre assisteuse pourra s’occuper de moi. Je demande à l’hôpital s’ils peuvent me transférer au Rwanda ; ils acceptent mais refuse un paiement de l’assurance ; ils souhaitent d’abord 500 dollars, sommes qui passe à 1000 dollars après quelques minutes de négociations. Ils me présentent également une facture de 50 dollars pour les soins effectués ; magnanimes, ils ne me font pas payer le pansement qu’ils ont remis sur le malade et qu’ils voulaient placer sur mon crâne. Le patient a ainsi son pansement, j’ai le crâne à l’air libre, ils viennent d’accepter mes 50 euros (je n’avais pas de monnaie en dollars), je peux commencer à chercher un chauffeur pour m’emmener à Kigali à trois heures de route de Goma.
Alors que la nuit est tombée, j’embrasse chaleureusement Michel et Paulin et traverse la frontière en payant un nouveau visa de 40 dollars. Je parviens à trouver le chauffeur qui m’avait conduit jusqu’à présent lors de mon séjour au Rwanda et qui avait été prévenu par Michel de mon arrivée à la frontière ; il me demande une certaine somme somme que je suis obligé de payer et qui me sera remboursée dès mon retour en France.
Je suis épuisé, mal en point et je peine à tenir debout n’ayant presque pas dormi depuis près de 48 heures. Je m’endors comme une masse dans le véhicule et ouvre les yeux devant le Royal hospital de Kigali. Entre temps, je remarque que j’ai reçu le numéro de téléphone de mon assisteuse, qui arrive quasiment en même temps que moi à l’hôpital dans lequel elle travaille en tant que médecin après un appel du poste de sécurité qui l’a prévenu de mon arrivée.
Professionnelle, cette femme d’une générosité sans borne me réconforte et s’occupe de mon admission ; les médecins me font passer plusieurs examens : scanners, radios. Bilan : trois côtes cassées, nez contusionné, trou à la tête, entorse niveau deux cheville gauche, entorse niveau trois cheville droite et infection de toutes les plaies.

J’intègre une chambre et n’aurai pas d’argent à avancer, Axa assistance s’étant occupé de tout.
Je parviens à m’endormir rapidement et je suis réveillé par le médecin le lendemain qui me pose deux plâtres. Je ne souhaite pas rester plus longtemps dans le pays, surtout depuis que je sais que je ne peux continuer mon voyage vers le Burundi et la Tanzanie voisine. Mon assisteuse se démène pour me faire partir le jour même dans un avion de Bruxelles airlines, en Business class.
A midi, je ne peux pas manger la nourriture de l’hôpital qui ne me donne pas envie ; je fais appeler un taxi qui m’emmène dans un hôtel ; je commande des spaghettis à la bolognaise et peut enfin manger un vrai repas et me détendre après toutes ces vicissitudes.
Le soir, mon assisteuse vient me chercher en compagnie d’un taxi dans lequel elle place mes deux nouvelles béquilles et mon bagage.
Nous arrivons à l’aéroport de Kigali en début de soirée ; pour procéder à l’enregistrement de mon bagage et récupérer mon ticket d’embarquement, je passe à une file spéciale réservée aux Business class. Le traitement est rapide et professionnel, même si les habits que je porte font tâches avec les costumes des autres voyageurs de la classe. Mais, un billet Business reste un billet Business.
En rejoignant la salle d’embarquement, mon billet me donne accès au salon Business avec tous les agréments qui vont avec : nourriture, café, lecture, télévision et boissons à volonté, dont champagne.
Lorsque nous embarquons, nous entrons en premier dans l’avion ; en Business, le sourire est de mise ; je découvre avec stupéfaction cette classe qui rend le voyage facile et agréable. Après m’être amusé avec les fonctionnalités de mon siège que je règle pour un maximum de confort, le premier repas m’est servi après plusieurs cocktails. Le repas est gastronomique et les aliments de premier choix, un vrai luxe.

Je m’endors sereinement. Le lendemain matin, le steward me réveille en douceur pour me proposer mon petit-déjeuner : à l’instar du repas de la veille, il s’avère riche et qualitatif.
Le temps de me débarbouiller dans les toilettes qui sont durant le vol, partagées avec le commandant de bord, je retourne à ma place alors que l’avion se pose sur la piste de l’aéroport de Bruxelles. Nous descendons en premier et je peux ainsi rejoindre la sortie de l’aéroport pour retrouver le chauffeur de taxi venant du Nord de la France que l’assurance m’a réservé.
Après 300 kilomètres jusqu’à la frontière française en compagnie d’un chauffeur agréable, je retrouve mon domicile et peux enfin dire : j’ai survécu à une chute sur les flancs d’un volcan. Si les américains étaient présents, je le ferai en chanson !











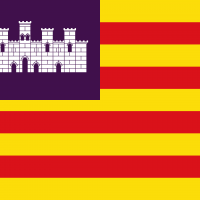









Pas de commentaires
Ecrire un commentaire